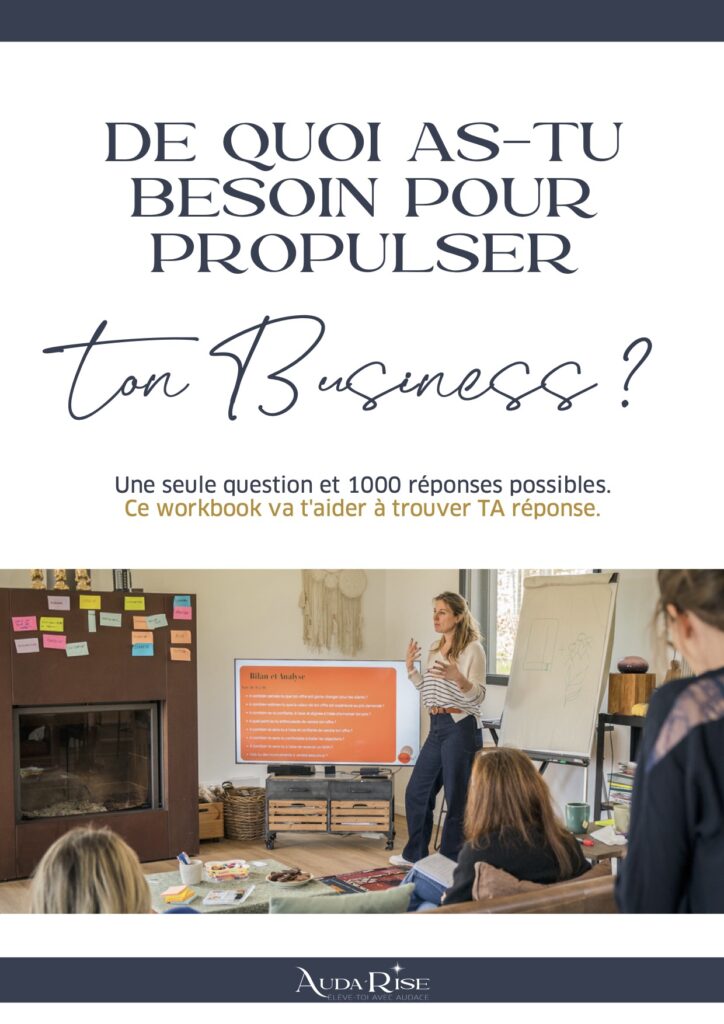Découvrez comment la théorie polyvagale explique le lien entre sécurité psychologique et innovation dans les équipes et les codir.
On associe souvent l’innovation à la créativité, aux idées disruptives, aux technologies de pointe. Pourtant, un facteur bien plus discret conditionne la capacité d’une équipe à innover : son état de sécurité intérieure et collective.
La théorie polyvagale, développée par Stephen Porges, met en lumière ce lien invisible. Elle montre que notre système nerveux détermine notre capacité à nous ouvrir, à collaborer et à imaginer de nouvelles solutions. Pour les codir et les managers, c’est une grille de lecture essentielle : sans sécurité, pas d’innovation durable.
Quand le stress bloque la créativité
Sous pression, le cerveau se met en mode survie. L’amygdale prend le dessus, focalisant l’attention sur les menaces immédiates. Dans cet état, le système nerveux privilégie la fuite, la lutte ou le figement. C’est efficace pour gérer une urgence, mais catastrophique pour innover.
Car innover demande l’inverse : explorer, prendre des risques, penser différemment. Si le collectif vit dans la peur de l’échec ou dans l’urgence permanente, la créativité se tarit. Les idées audacieuses sont censurées avant même d’être exprimées.
Le rôle de l’état ventral vagal
La théorie polyvagale décrit un état particulier du système nerveux : le mode ventral vagal. C’est l’état de sécurité et de connexion, celui où le corps se sent en confiance et ouvert à la relation.
Dans cet état, le cerveau libère plus facilement des neurotransmetteurs favorisant la curiosité et la coopération. Les collaborateurs osent proposer, tester, se tromper. Le codir devient un espace d’exploration plutôt qu’un tribunal. C’est là que naissent les idées réellement innovantes.
Comment créer un climat d’innovation avec la théorie polyvagale
Pour favoriser cet état collectif, il ne suffit pas d’organiser un “atelier créativité” ponctuel. L’enjeu est d’installer un climat de sécurité relationnelle durable. Cela passe par des signaux simples mais puissants : un manager qui écoute sans couper la parole, un codir qui valorise les essais même imparfaits, des rituels de réunion qui réduisent la pression plutôt que de l’amplifier.
Un environnement où l’on sait que l’erreur ne sera pas sanctionnée mais analysée devient un terreau fertile pour l’innovation. Les neurosciences confirment que le cerveau humain explore plus quand il se sent protégé que lorsqu’il se sent menacé.
L’innovation n’est pas seulement une question de méthode ou de budget R&D. Elle est avant tout une question d’état intérieur et de climat collectif. La théorie polyvagale le rappelle : sans sécurité, le système nerveux se ferme et répète les schémas connus. Avec sécurité, il s’ouvre et ose l’inédit.
Les managers et codir qui intègrent cette dimension deviennent des catalyseurs d’innovation. Ils comprennent que leur rôle n’est pas seulement de fixer un cap, mais de créer les conditions physiologiques et relationnelles qui rendent ce cap atteignable.
En d’autres termes : la sécurité n’est pas l’opposé de l’innovation. Elle en est le point de départ.